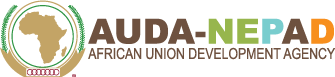Interview : Ibrahim Assane Mayaki, secrétaire exécutif du NEPAD

Le secrétaire exécutif du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), Ibrahim Assane Mayaki, explique, dans cet entretien qu'il nous accordé, les enjeux du nouveau partenariat avec les pays émergents dans lequel le continent africain s'est engagé. Pour lui, ce partenariat sud-sud peut permettre à l'Afrique d'amorcer son décollage économique, si les créneaux qu'il offre sont
judicieusement exploités.
Question : Vous participez à ce deuxième sommet Inde/Afrique d'Addis Ababa avec votre casquette de secrétaire exécutif du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Comment appréciez- vous le déroulement des travaux qui ont débuté depuis le 20 mai dernier, au siège de la Commission de l'Union africaine ?
Ibrahim Assane Mayaki : Le premier point, je pense qu'il est important d'abord de contextualiser cette conférence. Vous savez que l'Afrique a commencé à développer des partenariats de type sud-sud notamment avec la Chine, le Brésil et avec l'Inde. Ces partenariats s'inscrivent dans une révision de notre système d'intégration à la globalisation. Auparavant, nous étions fondamentalement caractérisés par des relations nord-sud ; ces relations nord-sud sont en train d'être remises en cause parce le monde devient multipolaire et il y a la présence très forte d'économies émergentes comme la Chine, le Brésil et l'Inde. Donc c'est dans ce contexte que l'Afrique estime qu'il est important de réviser cette coopération nord-sud et de privilégier la coopération sud-sud. Ça, c'est le premier point de contexte.
Le deuxième point, c'est que nous avons très longtemps fonctionné avec une très forte dépendance par rapport à l'aide, mais nous nous sommes rendu compte que l'aide n'est pas le facteur de développement. Le facteur de développement, c'est d'abord définir des politiques publiques appropriées et deuxièmement gérer stratégiquement les intérêts de l'Afrique et puis troisièmement construire nos propres industries, créer notre propre valeur ajoutée et promouvoir le commerce intra-africain.
Pour faire cela, nous avons les atouts nécessaires, maintenant nous avons évidemment besoin de partenariats et un partenariat comme celui de l'Inde peut nous permettre de travailler sur des questions d'économie de la connaissance, des questions d'investissements dans les domaines des infrastructures et de l'agriculture.
Le troisième point, c'est que l'Inde compte jusqu'à présent quand même un grand nombre d'habitants qui sont aussi pauvres qu'une bonne partie des habitants de l'Afrique, mais ils ont su développer des stratégies appropriées notamment dans l'agriculture par exemple et à travers un projet d'industrialisation très ferme aussi. Et n'oublions pas qu'ils sont également leader dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. De ce point de vue, les échanges avec l'Inde peuvent être vraiment bénéfiques et fructueux pour l'Afrique.
Ce sommet va permettre de concrétiser le partenariat à travers des actions concrètes dans les domaines de la recherche, de la télémédecine, de l'économie de la connaissance, de la formation et du renforcement de capacités, mais en même temps, comme il y a beaucoup de chefs d'entreprises indiens qui sont venus, cela va permettre de leur présenter des champs d'intervention sur lesquels on s'est mis d'accord pour qu'ils investir en partenariat avec des Africains dans ce domaine.
A l'occasion du conclave entre les investisseurs indiens et africains, vous avez souligné le caractère prioritaire de l'agriculture au niveau de l'Union africaine. Pour produire, il faut des terres. Or il se trouve que les partenaires indiens sont aussi impliqués dans la politique d'accaparement des terres agricoles en Afrique. Quelle est votre analyse de ce phénomène ?
D'abord, je le dis très clairement, nous sommes contre l'achat des terres visant à produire et à exporter directement ces productions là parce que premièrement cela ne crée pas de la valeur ajoutée sur place ; deuxièmement cette pratique lèse les intérêts des petits producteurs, les exploitations familiales notamment et troisièmement ça entraîne des phénomènes de corruption. Donc cette formule là ne marche pas. La formule que nous préconisons, que préconise l'Union africaine et l'agence du NEPAD, est la suivante : à l'intérieur de plans nationaux d'investissements agricoles bien définis, faire venir des partenaires du secteur privé indien pour leur proposer des investissements sur des opérations déjà définies. Que ça soit en amont par rapport aux intrants, que ça soit au niveau des systèmes de technologie de production agricole, machinismes et autres, que ça soit dans les processus de commercialisation. Mais il est très clair que ce qu'on appelle "Landgrabind " en anglais, c'est-à-dire juste donner des terres pour qu'il y ait une production et que cette production soit écoulée, ça c'est de la prostitution agricole, ce n'est pas du développement agricole.
Lors de la rencontre des investisseurs toujours, vous avez parlé d'une directive mise en application au niveau de l'Union européenne visant à accroître la production agricole de 6% chaque année dans les pays africains. Sur quels piliers repose cette directive ?
Il y a un cadre de référence stratégique qui est le Programme de développement détaillé de l'agriculture en Afrique (PDDA). Ce cadre de développement fait l'objet d'une régionalisation dans les communautés économiques régionales ; par exemple la CEDEAO a un cadre régional adapté au PDDA et ce cadre régional fait l'objet d'une traduction nationale à travers ce que j'ai appelé tout à l'heure les plans nationaux d'investissements agricoles. L'objectif qui est visé, c'est d'augmenter la productivité agricole de 6% à travers une meilleure gestion des intrants, à travers une formation des producteurs, et à travers des mécanismes d'appui à l'agriculture, notamment l'agriculture familiale parce que la majorité des producteurs ont de petites exploitations familiales.
Donc pendant que des pays au niveau de l'Europe et des Etats Unis subventionnent très fortement leur agriculture, nous nous ne pouvons pas ne pas appuyer notre secteur agricole et précisément les producteurs et ça c'est le rôle de l'Etat. Maintenant le secteur privé a également son rôle à jouer dans cette dynamique au niveau de la création de la valeur ajoutée à travers notamment des unités de transformation des produits agricoles.
L'autre point qui est important, il ne faut pas que nous mettions de côté la recherche parce que, en utilisant des semences améliorées, il est évident que cela contribuera à améliorer la productivité agricole. Le deuxième point du consensus est que si on estime que l'agriculture est une priorité, il faut que les Etats mettent plus d'argent public dans le secteur. Et c'est pour cela qu'un sommet de l'Union africaine à Maputo, il y a environ sept à huit ans, avait pris la décision d'amener les Etats africains d'investir au moins 10% de leurs ressources publiques (leurs budgets) dans le secteur agricole. Nous pensons que s'il y a un cadre politique approprié, s'il y a des investissements appropriés, s'il y a l'appui aux producteurs, on peut atteindre cet objectif là.
Par rapport à cette politique, qu'est-ce qui a pu être mise en oeuvre concrètement à la date d'aujourd'hui ?
Pour ce qui concerne le programme continental détaillé de développement de l'agriculture, tous les Etats de la CEDEAO ont actuellement un programme national d'investissements agricoles et la majorité d'entre eux a organisé des tables rondes pour attirer le secteur privé d'une part, et a décidé, sur ses propres ressources, d'investir dans le secteur d'autre part. Donc ça c'est une illustration concrète.
Mais au-delà de ces 15 pays de la CEDEAO, il y a huit autres pays dans les autres régions qui ont également finalisé le processus par lequel on aboutit à un plan national d'investissements agricoles.
Maintenant notre grande responsabilité, c'est de faire en sorte que la majorité des pays africains adoptent ce cadre stratégique, deuxièmement que l'on soit très soucieux et vigilant sur les mesures d'appui aux producteurs et troisièmement qu'on associe le secteur privé au financement des plans.
Une autre priorité de l'Union africaine, c'est le renforcement des infrastructures de communication. Pourquoi la priorisation de ce secteur ?
Les infrastructures sont vraiment une priorité pour nous parce que d'une part elles vont favoriser le commerce intra-africain et deuxièmement, elles vont nous permettre de construire nos marchés intérieurs. Si vous analysez aujourd'hui le coût de transport d'une marchandise entre Cotonou et Ouagadougou, vous verrez qu'il est plus élevé qu'entre Ouagadougou et Shanghai, c'est totalement aberrant ! Ça c'est non seulement lié à des questions d'infrastructures dures, mais aussi à des questions plus souples qui ont trait au transport auxquelles nous devons nous attaquer. La caractéristique des infrastructures construites pendant la colonisation et après la colonisation, c'est essentiellement des systèmes qui permettaient d'exploiter les minerais et produits agricoles et puis de les sortir. Ce que nous nous cherchons à faire, c'est connecter les pays africains pour qu'ils puissent construire leurs marchés intérieurs. Et dans ce cadre là, au niveau des communautés économiques régionales comme la SADC, la COMESA, la CEDEAO, il y a des plans d'infrastructures très précis que ça soit en transport ou en énergie visant à connecter les pays. Cette priorité va être renforcée en 2012 avec l'adoption du PIDA qui est le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique et qui est l'équivalent du PDDA dans le domaine agricole.
Interview réalisée par Ousseini Issa